Mais ceux qui n'ont rien à faire demain soir peuvent se rendre au lancement dur ecueil "un dimanche à table" dans lequel sera publiée une de mes nouvelles.
Les infos sont là !
Le blog littéraire de Michel Goussu. Des chroniques de livres de poche. Littérature contemporaine, ou non, française, ou non. Diffusées dans l'émission Des Poches Sous Les Yeux, de Radio Béton, pour les poches. Parfois, juste pour vous. Et un peu de promotion pour mon premier roman, Le Poisson pourrit par la tête, au Castor Astral.

 En fait, l'enchaînement des naissance et des abandons n'est qu'un prétexte dont Gisèle Pineau se sert pour décrire la vie d'un quartier défavorisé de Guadeloupe. Sa volonté de représenter les habitants de la Ravine Claire, représenter au sens démocratique, presque institutionnel du terme, encombre le livre de Gisèle Pineau. Cent vie et des poussières souffre d'une écriture parfois maladroite qui devrait nous agacer et d'une construction parfois répétitive qui devrait nous éloigner. Mais ces imperfections, au contraire, rendent le livre sympathique, tout comme on préfère un élu local un peu maladroit à la roublardise d'un politicien professionnel. Ce qu'on perd en style, on le gagne en véracité, en proximité. On entre dans les maisons, dans les cuisines, dans les chambres à coucher. Pas en voyeur, non, en voisin, en confident d'une jeune femme complètement dépassée par un désir animal, hormonal, violent, même. Une force issue des profondeurs de l'évolution : l'irrépressible désir de donner la vie.
En fait, l'enchaînement des naissance et des abandons n'est qu'un prétexte dont Gisèle Pineau se sert pour décrire la vie d'un quartier défavorisé de Guadeloupe. Sa volonté de représenter les habitants de la Ravine Claire, représenter au sens démocratique, presque institutionnel du terme, encombre le livre de Gisèle Pineau. Cent vie et des poussières souffre d'une écriture parfois maladroite qui devrait nous agacer et d'une construction parfois répétitive qui devrait nous éloigner. Mais ces imperfections, au contraire, rendent le livre sympathique, tout comme on préfère un élu local un peu maladroit à la roublardise d'un politicien professionnel. Ce qu'on perd en style, on le gagne en véracité, en proximité. On entre dans les maisons, dans les cuisines, dans les chambres à coucher. Pas en voyeur, non, en voisin, en confident d'une jeune femme complètement dépassée par un désir animal, hormonal, violent, même. Une force issue des profondeurs de l'évolution : l'irrépressible désir de donner la vie. 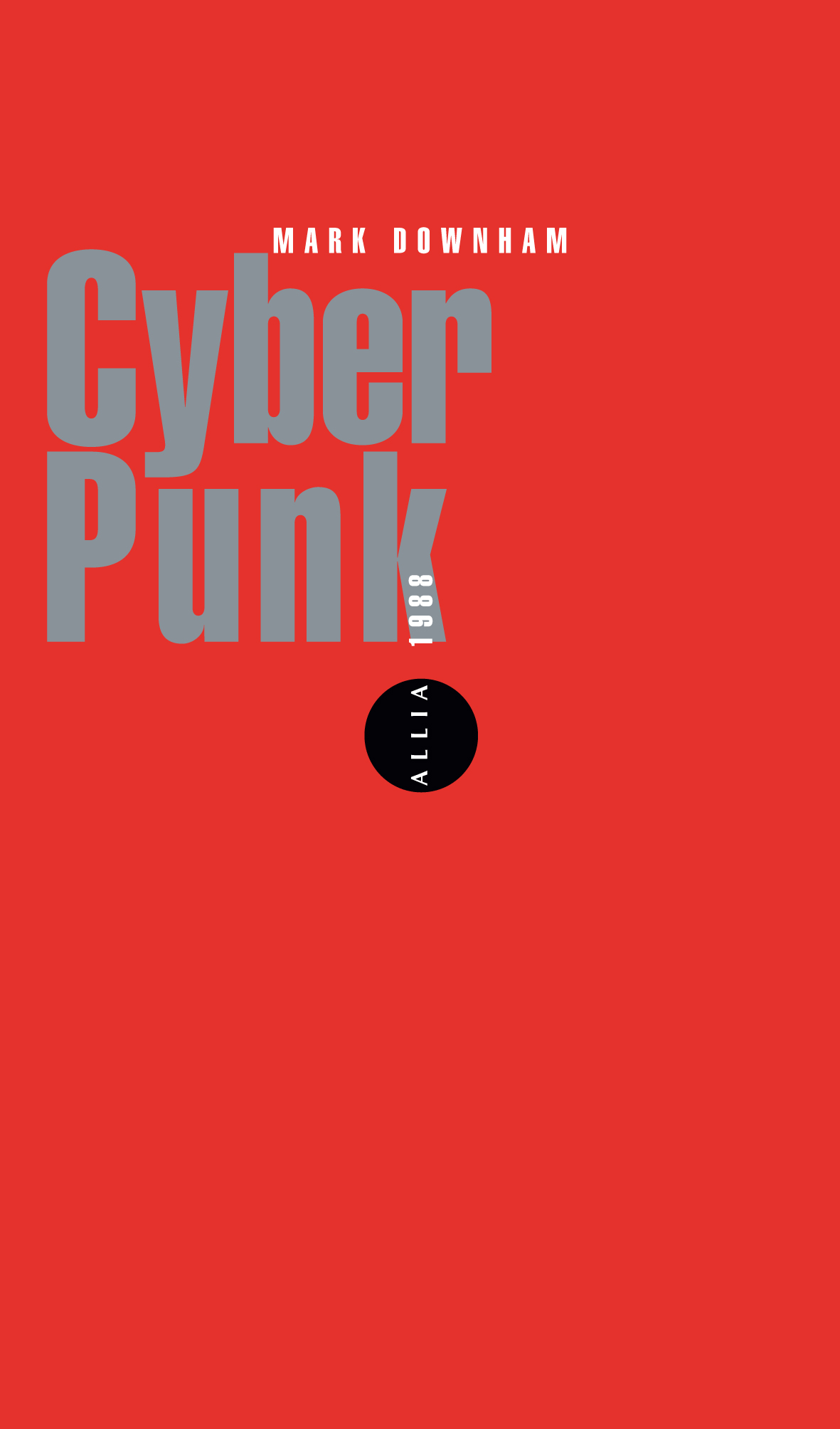 Cyberpunk
est truffé d'intuitions visionnaires, mais les termes ont mal
vieilli. Mark Downham avait prédit ce déversement fascinant et
effrayant d'images incontrôlables mais il avait appelé Youtube le
vidéodrome et le terme évoque le ruban disparu de feues nos cassettes
VHS. Bien-sûr, la lente dissolution du caractère subversif des
réseaux informatiques dans le déterminisme technologique est une
prophétie qui ne cesse de se réaliser. Mais Mark Downham lui donne
le nom de métrophage, et on ne peut s'empêcher de sourire.
Cyberpunk
est truffé d'intuitions visionnaires, mais les termes ont mal
vieilli. Mark Downham avait prédit ce déversement fascinant et
effrayant d'images incontrôlables mais il avait appelé Youtube le
vidéodrome et le terme évoque le ruban disparu de feues nos cassettes
VHS. Bien-sûr, la lente dissolution du caractère subversif des
réseaux informatiques dans le déterminisme technologique est une
prophétie qui ne cesse de se réaliser. Mais Mark Downham lui donne
le nom de métrophage, et on ne peut s'empêcher de sourire.
 Comme
dans tous les voyages il faut d'abord dépasser la barrière de la
langue. Celle de Liu Yichang, même traduite, laisse une impression
étrange, un caractère direct, presque familier, qui rappelle les
dialogues des films de Hong Kong, où se déroule d'ailleurs
l'intrigue. Mais peut-on parler d'intrigue ? Ici pas de destin,
pas de rebondissement, l'irruption du sens à l'occidentale est
remplacée par l'éruption des sens. On entend crier au voleur, on
voit un jeune homme aux cheveux longs s'enfuir dans la foule, on sent
les odeurs de la rue, et la force de l'alcool nous fait parfois
claquer la langue. Et toujours contre soi on sent le contact de la
foule. Ou alors c'est parce que je lis debout, serré dans le bus ?
Lorsque le mien pile, ceux de Hong Kong se rentrent dedans et ils
sortent la jeune héroïne, A Xing, d'une rêverie où elle se voyait
adulée par les foules, parfois actrice, parfois chanteuse, mais
toujours au bras d'un mari auquel elle prête volontiers les traits
d'Alain Delon. Malgré ses quinze ans, malgré la naïveté de ses
rêveries de midinette, il y a déjà du cynisme chez cette
adolescente Elle ne rêve pas d'amour, mais de porte de sortie. Le
mariage est une alternative à l'usine, au travail en général, et
la rêverie, un refus de l'avenir qui l'attend.
Comme
dans tous les voyages il faut d'abord dépasser la barrière de la
langue. Celle de Liu Yichang, même traduite, laisse une impression
étrange, un caractère direct, presque familier, qui rappelle les
dialogues des films de Hong Kong, où se déroule d'ailleurs
l'intrigue. Mais peut-on parler d'intrigue ? Ici pas de destin,
pas de rebondissement, l'irruption du sens à l'occidentale est
remplacée par l'éruption des sens. On entend crier au voleur, on
voit un jeune homme aux cheveux longs s'enfuir dans la foule, on sent
les odeurs de la rue, et la force de l'alcool nous fait parfois
claquer la langue. Et toujours contre soi on sent le contact de la
foule. Ou alors c'est parce que je lis debout, serré dans le bus ?
Lorsque le mien pile, ceux de Hong Kong se rentrent dedans et ils
sortent la jeune héroïne, A Xing, d'une rêverie où elle se voyait
adulée par les foules, parfois actrice, parfois chanteuse, mais
toujours au bras d'un mari auquel elle prête volontiers les traits
d'Alain Delon. Malgré ses quinze ans, malgré la naïveté de ses
rêveries de midinette, il y a déjà du cynisme chez cette
adolescente Elle ne rêve pas d'amour, mais de porte de sortie. Le
mariage est une alternative à l'usine, au travail en général, et
la rêverie, un refus de l'avenir qui l'attend.
 « Mesdames,
Messieurs... le protocole demande que ce discours en séance publique
commence par un hommage au dernier mort en date, et l'usage voudrait
que j'ajoute : ''dont j'ai scrupule à occuper la place''. »
« Mesdames,
Messieurs... le protocole demande que ce discours en séance publique
commence par un hommage au dernier mort en date, et l'usage voudrait
que j'ajoute : ''dont j'ai scrupule à occuper la place''. » J'ai chroniqué assez durement "Comment parler des livres que l'on n'a pas lus", parce qu’il me semblait que Pierre Bayard y survalorisait le désir de montrer sa culture au plaisir hédoniste de la lecture. Le ministère des affaires étrangères a réglé pour nous ce dilemme en permettant au génie français de parvenir jusqu'à nos petites cervelles sous la forme de condensés élégants au sein desquels la pensée d'un membre mort de l'establishment philo-littéraire est embaumée par un membre vivant ( du moins lors de la rédaction de l'opuscule).
J'ai chroniqué assez durement "Comment parler des livres que l'on n'a pas lus", parce qu’il me semblait que Pierre Bayard y survalorisait le désir de montrer sa culture au plaisir hédoniste de la lecture. Le ministère des affaires étrangères a réglé pour nous ce dilemme en permettant au génie français de parvenir jusqu'à nos petites cervelles sous la forme de condensés élégants au sein desquels la pensée d'un membre mort de l'establishment philo-littéraire est embaumée par un membre vivant ( du moins lors de la rédaction de l'opuscule).  Je me
maudis de ne pas avoir pris des boules Quies et j'ouvre Le goût âpre
des kakis de Zoyâ Pirzad aux éditions Le livre de Poche. J'ai à
peine le temps de me rappeler que j'aime le papier un petit peu
grossier de ces éditions audacieuses et pas trop chères et tout
disparaît. Le bus, l'espace, le temps, le Elle.
Je me
maudis de ne pas avoir pris des boules Quies et j'ouvre Le goût âpre
des kakis de Zoyâ Pirzad aux éditions Le livre de Poche. J'ai à
peine le temps de me rappeler que j'aime le papier un petit peu
grossier de ces éditions audacieuses et pas trop chères et tout
disparaît. Le bus, l'espace, le temps, le Elle.
 Mais
Romain Gary est un auteur plus complexe. Pas un auteur compliqué,
dur à lire, non, chacun des articles ou des entretiens ici compilés
est limpide, mais sa pensée est assez vaste pour être difficile à
appréhender. Romain Gary, c'est un peu le frigidaire dans un
déménagement. Si on ne peut pas le porter tout seul, ce n'est pas
parce que c'est lourd, c'est parce qu'on ne on ne sait pas par où
l'attraper. Né en Lituanie, élevé en Pologne, puis en France,
aviateur, compagnon de la libération, ambassadeur de France aux
États Unis, Romain Gary c'est le mouvement, pas la doctrine figée.
Le seul concept qu'il semble défendre de façon absolue, c'est la
nécessité de ne pas voir les choses de façon absolue. La marge
humaine.
Mais
Romain Gary est un auteur plus complexe. Pas un auteur compliqué,
dur à lire, non, chacun des articles ou des entretiens ici compilés
est limpide, mais sa pensée est assez vaste pour être difficile à
appréhender. Romain Gary, c'est un peu le frigidaire dans un
déménagement. Si on ne peut pas le porter tout seul, ce n'est pas
parce que c'est lourd, c'est parce qu'on ne on ne sait pas par où
l'attraper. Né en Lituanie, élevé en Pologne, puis en France,
aviateur, compagnon de la libération, ambassadeur de France aux
États Unis, Romain Gary c'est le mouvement, pas la doctrine figée.
Le seul concept qu'il semble défendre de façon absolue, c'est la
nécessité de ne pas voir les choses de façon absolue. La marge
humaine.
 Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? de Pierre Bayard, aux Éditions de Minuit.
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? de Pierre Bayard, aux Éditions de Minuit.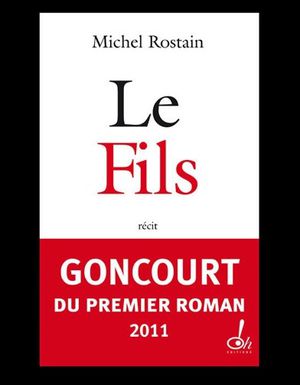 Les
livres dont le sujet est poignant prennent un peu leur lecteur en
otage. Qui oserait dire qu'il trouve lamentable l'histoire d'une
handicapée ou qu'il a trouvé mal écrit le témoignage d'un père
qui vient de perdre son fils d'une maladie rare et foudroyante ?
C'est peut-être parce que Michel Rostain ne livre pas un témoignage
mais un véritable roman que j'ose enfin écrire combien son livre,
le Fils, paru chez Oh ! Éditions m'a été désagréable. C'est
peut-être aussi parce que j'ai perdu mon père ce mois-ci et qu'il
me paraîtrait grotesque et indécent d'écrire un livre où il
parlerait, à la première personne de son fils resté vivant.
Les
livres dont le sujet est poignant prennent un peu leur lecteur en
otage. Qui oserait dire qu'il trouve lamentable l'histoire d'une
handicapée ou qu'il a trouvé mal écrit le témoignage d'un père
qui vient de perdre son fils d'une maladie rare et foudroyante ?
C'est peut-être parce que Michel Rostain ne livre pas un témoignage
mais un véritable roman que j'ose enfin écrire combien son livre,
le Fils, paru chez Oh ! Éditions m'a été désagréable. C'est
peut-être aussi parce que j'ai perdu mon père ce mois-ci et qu'il
me paraîtrait grotesque et indécent d'écrire un livre où il
parlerait, à la première personne de son fils resté vivant.
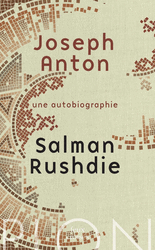 Je suis
étonné qu'on ait si peu parlé de Joseph Anton, l'autobiographie de
Salman Rushdie parue cette année chez Plon. C'est peut-être parce
que ce genre de livre est le calvaire du chroniqueur. Plus de 700
pages, parfois lourdes, pesantes, parfois même ennuyeuses, mais dont
il est impossible de sauter une seule tant ce livre est important,
majeur.
Je suis
étonné qu'on ait si peu parlé de Joseph Anton, l'autobiographie de
Salman Rushdie parue cette année chez Plon. C'est peut-être parce
que ce genre de livre est le calvaire du chroniqueur. Plus de 700
pages, parfois lourdes, pesantes, parfois même ennuyeuses, mais dont
il est impossible de sauter une seule tant ce livre est important,
majeur.
 Une façon pour les
blogs ayant moins de 200 abonnés de faire connaître d'autres blogs
ayant moins de 200 abonnés. En fait, c'est un genre de chaîne de
mails pour les blogs. Si on y répond, alors plein de gens vont venir
voir votre blog, un éditeur va vous remarquer, vous recommander à
un mass-média qui vous suppliera de travailler pour eux. À genoux.
Et pour un gros salaires et plein d'avantages en nature (jet privé,
détartrage dentaire offert chaque année, ticket restaurant de
7€50, réduction pour le concert de Raphaël). En revanche, si vous ne répondez pas, votre blog ne sera
plus jamais consulté, à part par Par-is Hilton (c'était pour faire
Part par par).
Une façon pour les
blogs ayant moins de 200 abonnés de faire connaître d'autres blogs
ayant moins de 200 abonnés. En fait, c'est un genre de chaîne de
mails pour les blogs. Si on y répond, alors plein de gens vont venir
voir votre blog, un éditeur va vous remarquer, vous recommander à
un mass-média qui vous suppliera de travailler pour eux. À genoux.
Et pour un gros salaires et plein d'avantages en nature (jet privé,
détartrage dentaire offert chaque année, ticket restaurant de
7€50, réduction pour le concert de Raphaël). En revanche, si vous ne répondez pas, votre blog ne sera
plus jamais consulté, à part par Par-is Hilton (c'était pour faire
Part par par).
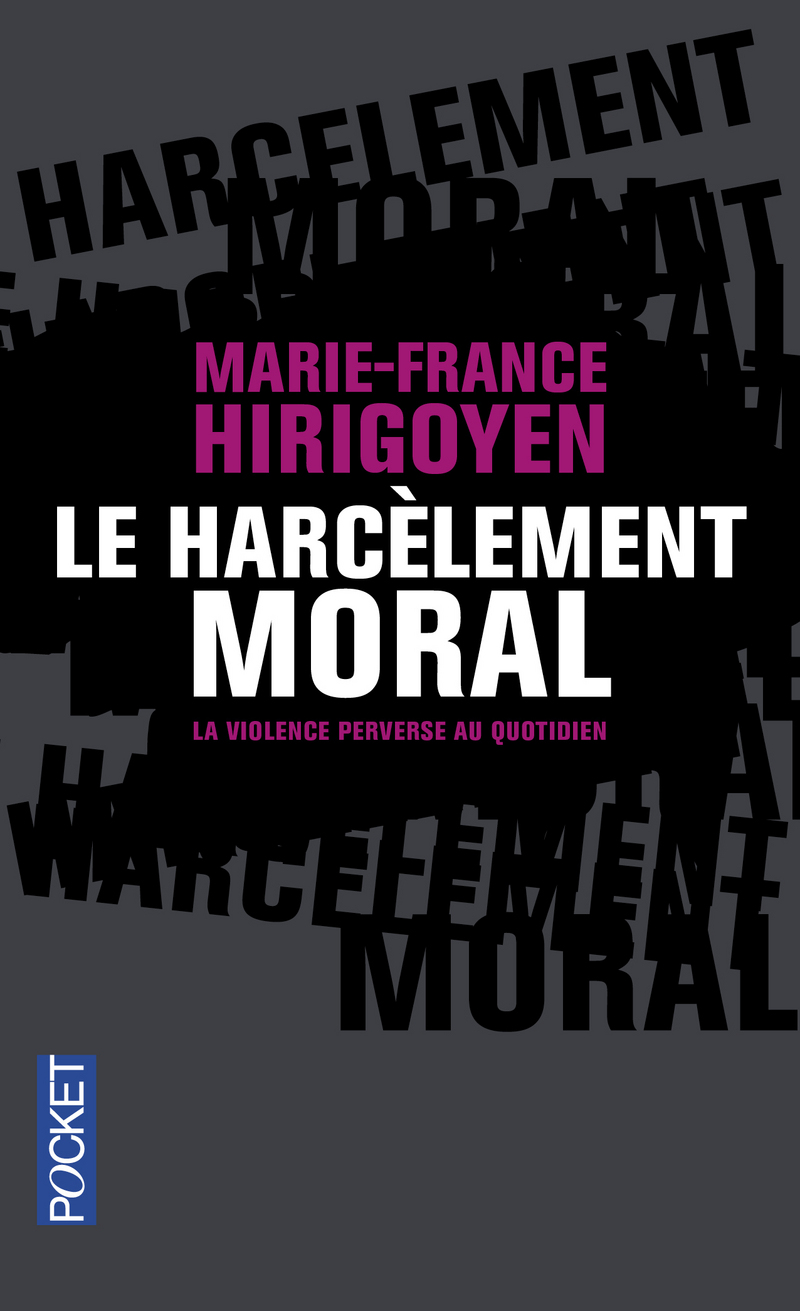 Le
sous-titre explique ce à quoi le livre veut vous faire échapper :
la violence perverse au quotidien. C'est d’ailleurs un présupposé
fort et discutable du livre ; le harcèlement moral serait
toujours l'œuvre d'un pervers narcissique. Même si cela correspond
en partie à l'expérience que j'ai pu vivre, il me semble que c'est
réducteur.
Le
sous-titre explique ce à quoi le livre veut vous faire échapper :
la violence perverse au quotidien. C'est d’ailleurs un présupposé
fort et discutable du livre ; le harcèlement moral serait
toujours l'œuvre d'un pervers narcissique. Même si cela correspond
en partie à l'expérience que j'ai pu vivre, il me semble que c'est
réducteur.