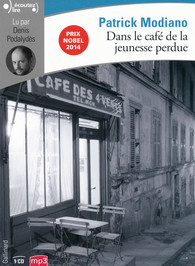Il faut lire La nuit, d'Elie Wiesel. On le trouve en poche dans la collection Double des éditions de minuit. On le trouve en livre audio dans la collection Écoutez lire de Gallimard, plutôt bien lu par Guila Clara Kessous.
Elie est un adolescent juif né à la fin des années vingt. Sa foi est le point de convergence de son intelligence, de sa sensibilité et de sa fidélité à la tradition dont il est issu. Et les trois, l'intelligence, la sensibilité, la fidélité, seront autant d'amplificateurs de l'horreur qu'il décrit. Il faut lire le récit de cette horreur, avant tout parce qu'il est lisible. Le génie littéraire d'Elie Wiesel produit un témoignage assez précis pour nous faire effleurer, seulement effleurer, l'horreur absolue. L'horreur d'une extermination organisée par un appareil d'état. Mais la précision du récit est rendue supportable par l'écriture qui porte ce témoignage. L'écriture nous soutient dans l'exercice d'acceptation nécessaire. Parce que le risque du témoignage brut, c'est que l'horreur soit telle qu'on ne puisse aller au bout du récit. Le risque c'est que devant une horreur impossible à accepter le lecteur se dise, non, ce n'est pas possible, non, cela ne me concerne pas, non je n'y crois pas. Il y a parmi les révisionnistes, des gens qui ne peuvent simplement pas vivre, continuer à vivre, avec la conscience de ce que l'humanité a pu faire. Pas une humanité lointaine et différente de nous, mais l'humanité d'une société occidentale moderne, évoluée, capable de poésie, de science, notre humanité.
Elie Wiesel nous guide à travers la nuit et nous cherchons sa main comme lui cherche celle de son père. Les sélections se succèdent, et Elie n'a pas seulement peur de mourir, il a peur de vivre et que son père soit poussé dans la mauvaise file. Car les juifs savent, on leur a montré la cheminée, la lueur, la flamme, les chambres. Le témoignage, bien qu'écrit dix ans après la libération des camps, relate ces choses avec le caractère implacable du quotidien, la description sans fard de la chose vue, la sagacité d'un adolescent figée à jamais par le choc. Wiesel n'insiste jamais sur la souffrance, il suffit d'un détail pour qu'on la ressente, et qu'on ait envie de prendre tous ces gens dans ses bras, même si c'est idiot. La libération si proche nous fait espérer tout du long, alors que nous savons, oui, le père d'Elie Wiesel est mort là-bas, nous savons, aussi, par la quatrième de couverture qu'Elie Wiesel ne pourra se pardonner de ne pas l'avoir accompagné plus humainement.
Alors il faut lire La nuit, d'Elie Wiesel, égoïstement, parce que le récit de celui qui a tout perdu donne
de la valeur a tout ce que nous avons. Chaque page nous hurle que nos vies, nos petites vies qui nous semblent sans intérêt sont des rivières de lait et de miel. Chaque page nous montre du doigt ceux qu'on aime : vite, les aimer, les aimer bien, le pire peut arriver. Au fond du fond le pire c'est lorsque le manque de pain empêche de continuer à aimer les siens. Alors c'est idiot, et nous sommes ainsi fait que ça ne dure pas, mais pendant toute la lecture du livre, chaque repas me semblait luxueux, vraiment, et je profitais de la chaleur des douches que je prenais. Nous vivons, du moins la plupart d'entre nous, dans un luxe relatif que nous ne mesurons plus. Il faut lire La nuit, d'Elie Wiesel, comme des égoïstes, pour voir à nouveau le luxe de nos vies. Il faut lire La nuit, d'Elie Wiesel, avec générosité aussi, pour se rappeler que l'humanité ne peut s'offrir le luxe de choisir parmi elle des boucs-émissaires, juifs, roms, pédés, qu'il faut faire l'effort, pénible, parce que sans cesse recommencé de chercher des solutions, pour ne pas croire à nouveau en une solution finale. On aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, me dire que tout ça est derrière nous, mais lorsque les temps son durs, lorsque les hommes ont peur, il faut relire la Nuit, d'Elie Wiesel, que ce soit en poche, chez Minuit ou en Audiobook dans la collection Écoutez Lire chez Gallimard.
L'audio sera mis en ligne dès que j'aurais eu le temps de le faire.