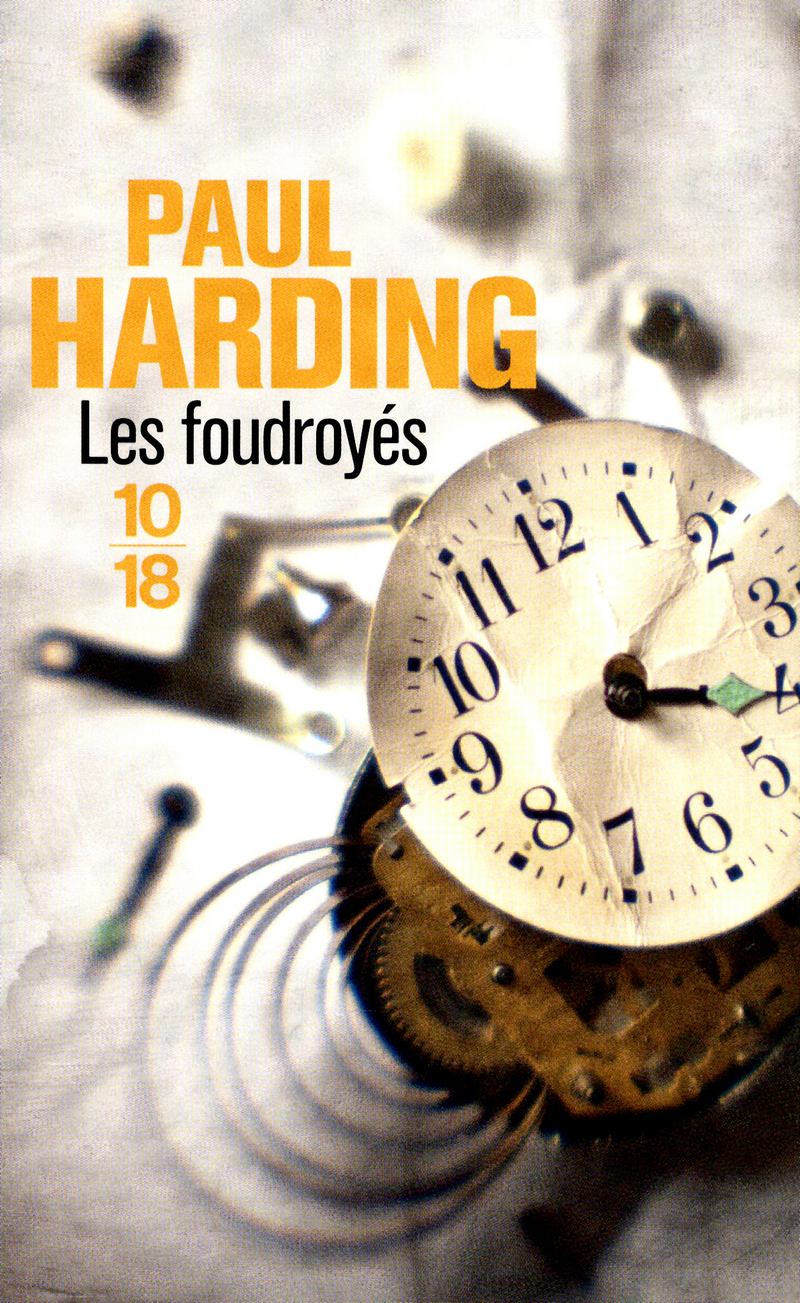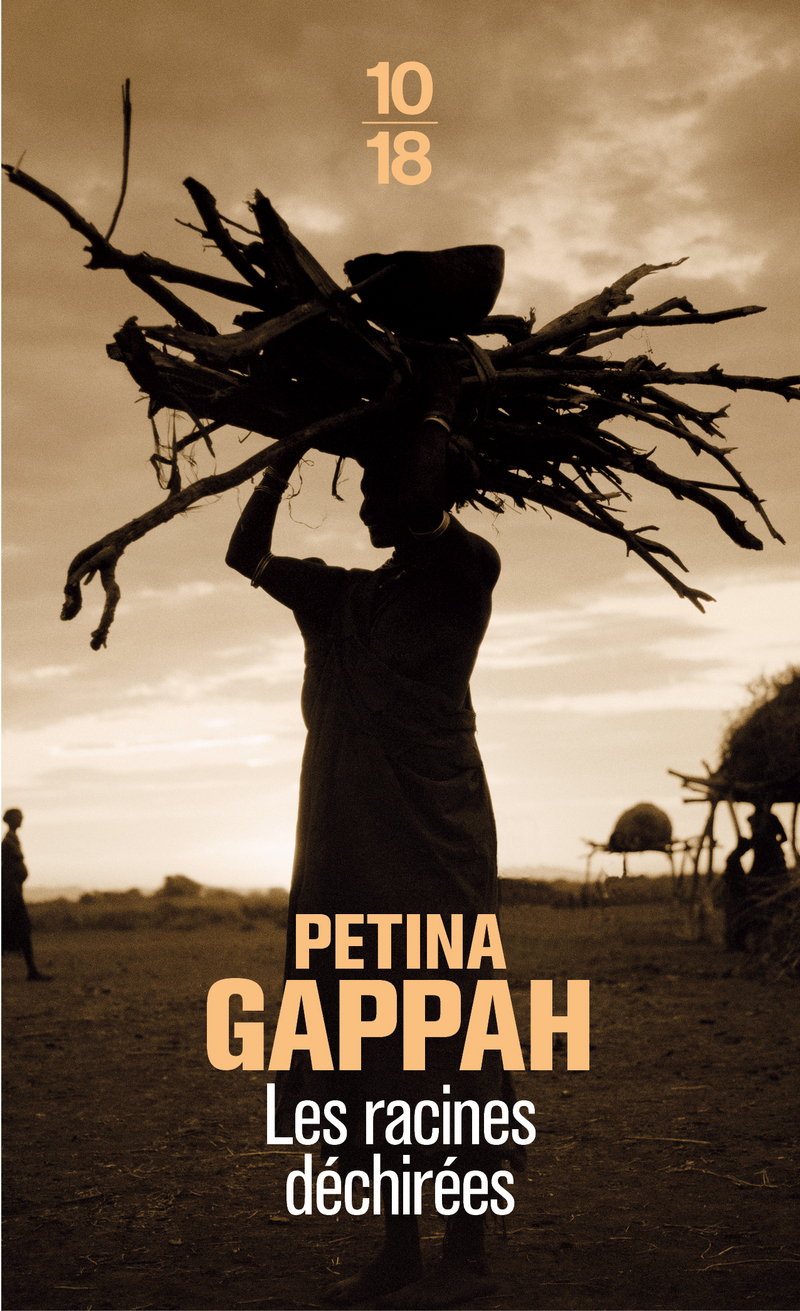 Les racines déchirées est le premier recueil de nouvelles de Petina Gappah, disponible en poche chez 10-18. Le titre est un peu grandiloquent, comme s'il était impossible de parler d'Afrique sans évoquer les racines, le folklore. Mais c'est l'éditeur français qui a fait ce choix, car le titre original reprenait celui d'une des nouvelles. Petinah Gappah, elle, évite tous les clichés, tous les écueils de l’écrivain africain qui écrit pour le monde entier. Pas de pittoresque inutile, ni de misérabilisme, pas de revendication balourde : chaque nouvelle décrit un morceau de la réalité d'un pays qui n'a pas su prendre le virage de l'indépendance.
Les racines déchirées est le premier recueil de nouvelles de Petina Gappah, disponible en poche chez 10-18. Le titre est un peu grandiloquent, comme s'il était impossible de parler d'Afrique sans évoquer les racines, le folklore. Mais c'est l'éditeur français qui a fait ce choix, car le titre original reprenait celui d'une des nouvelles. Petinah Gappah, elle, évite tous les clichés, tous les écueils de l’écrivain africain qui écrit pour le monde entier. Pas de pittoresque inutile, ni de misérabilisme, pas de revendication balourde : chaque nouvelle décrit un morceau de la réalité d'un pays qui n'a pas su prendre le virage de l'indépendance.
Petinah Gappah change de sujet, de protagonistes, mais elle conserve sa capacité à faire le pas de côté qui lui permet de toujours trouver un angle inattendu. Pour nous parler de la rapidité avec laquelle on s'élève puis on tombe en disgrâce dans un régime révolutionnaire, elle décrit une femme qui pleure un cercueil qui ne contient pas la dépouille de son mari. Pour nous montrer la réalité des townships, elle décrit les extrémités auxquelles peut pousser le désir d'enfant. Et quand d'autres plus maladroits expliqueraient qu'un pays à qui on n'a pas laissé le temps de développer ses élites ne produit que des fonctionnaires incompétents, cupides et naïfs, elle raconte une histoire d'arnaque à la nigériane, dérisoire et tragique.
On aurait aimé, parfois, enfin, j'aurais aimé, reconnaître un style, une langue spécifique, mais Petina Gappah prend à chaque fois la voix de ses protagonistes. Et c'est avec cet air de ne pas y toucher que l'auteure nous touche, parce que la pire des condamnations est rarement dans le réquisitoire, dans l'accusation, la récrimination, la pire des condamnations, c'est souvent la vérité toute nue, toute simple, celle des gens qui ne se révoltent même plus contre elle, celle qui n'a pas besoin qu'on la rehausse de couleurs criardes.
Les lèvres des malades du sida sont simplement plus roses, la peau du propriétaire indien qui résiste à tous les changements de régime plus sombre, plus criard le pantalon de cet expatriée qui fait rêver tout le pays et cache la misère de l'émigration, car elle reste préférable à ce pays dont l'argent sans cesse dévalué ne permet d'acheter que les fonctionnaires corrompus.
Ce pays, c'est le Zimbabwe. Et quand Petina Gappah laisse traîner des repères chronologiques, on réalise que tout ça dure depuis des décennies. On s'y est habitué, comme les personnages s'habituent à Mugabe, comme on s'habitue à la langue de bois autoritaire qui annonce puis accompagne les dictatures de tous les pays. Alors, pour résister à l'uniformisation, à la déréalisation du vocabulaire, Petina Gappah varie les registres, le ton, elle laisse non traduites beaucoup d'expressions dont on devine le sens par le contexte et dont la musique nous rassure, nous réjouit. La parole vivante est la marque de la vie, de l'humain, et l'universalité des histoires que raconte Petinah Gappah dans les racines déchirées, remarquablement traduites chez 10-18 par Anouk Neuhoff, devrait nous interroger sur notre passivité devant l'appauvrissement lexical, devant la relégation de la littérature aux marges de la société de consommation, devant la disparition progressive d'une classe moyenne heureuse, tous ces clichés face auxquels il faudrait, comme Petina Gappah, savoir faire un pas de côté pour les décrire avec la même bienveillance impitoyable.
L'audio est disponible ici, avec un fond sonore de Chamunorwa Nebeta & The Glare Express, un groupe Zimbabwéen cité dans le livre.
Oui, bon, ben ceux qui repèrent que je dis que "pas besoin de couleurs criardes", avant de décrire le "pantalon criard", ajoutant ainsi à la contradiction la répétition, z'ont qu'à me trouver un boulot, et je pourrai me coucher plus tôt et être moins crevé pour faire mes chroniques. Ou juste un salaire, tiens, je pourrai ainsi me remettre à écrire des romans.