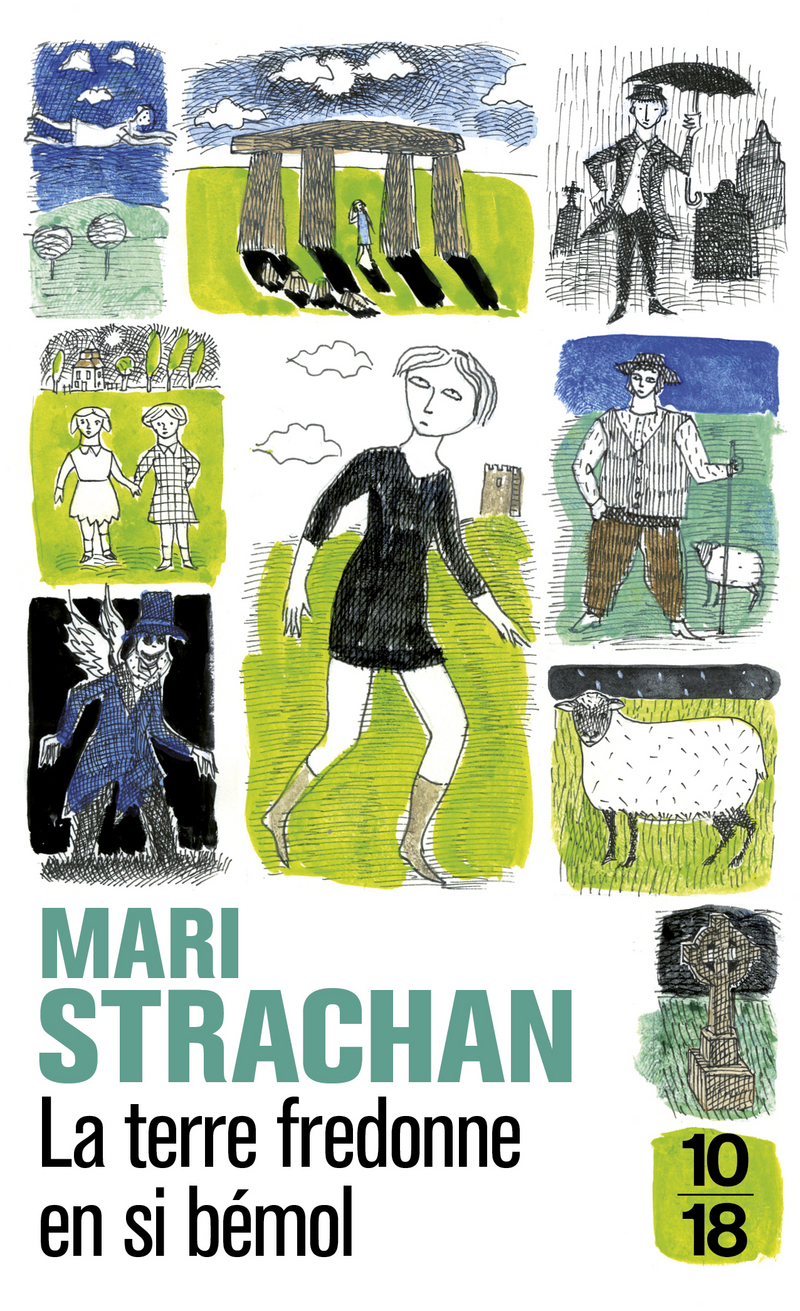Je ne sais pas trop combien de pages de La Maison de Sugar Beach, paru au Livre de Poche, m'ont été nécessaires pour comprendre que l'auteur, Helene Cooper, était noire. Elle parle comme une gosse de riche, et victime de mes stéréotypes, j'y ai vu un comportement de blanc. Ce livre vous débarrasse de cette forme insidieuse de racisme, les esclaves américains affranchis qui fondent le Liberia sont des colons comme les autres. Leurs descendants, que les colonisés appellent des Congos, se comportent comme toutes les classes dominantes, avec une injustice bienveillante, la condescendance que donne le pouvoir, et une inconscience totale de la menace que fait planer sur eux l'amplitude des inégalités. Hélène Cooper se montre telle qu'elle était alors, petite congo des années 70, capricieuse, entourée de domestiques dans sa maison élégante, en sursis entre la plage et la jungle.
On sent que le récit ne va pas bien se terminer, et le décalage qu'il y a entre l'enfance dorée d'Hélène Cooper et ce qu'on croit savoir des atrocités, des massacres, de la guerre civile, des guerres civiles libériennes fait planer une sorte de suspense terrifiant. L'adoption d'une petite sœur de substitution issue d'une famille défavorisée ajoute un ingrédient de tragédie grecque : c'est comme attendre une catastrophe, pour qu'elle s'accomplisse.
On apprend beaucoup sur le Liberia, comment il fut fondé, et comme il se meurt. On apprend plus encore sur Hélène Cooper, sa généalogie, son enfance, son quotidien. Helene Cooper, qui est devenue journaliste, a dû s'habituer à écrire des articles avec une information rare, maigre, parcellaire. Du coup, elle semble comme encombrée par son passé, sur lequel elle sait tout, raconte tout, jusqu'à l'ennui. On aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, qu'elle nous épargnât quelques répétitions, quelques personnages qui encombrent le récit, non parce qu'ils sont trop nombreux, mais parce qu'ils sont à peine esquissés. Pourquoi eux plutôt que d'autres ? Parce qu'ils sont ses oncles, ses grand-mères, ses cousins. Sa petite famille dorée et adorée.
Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du livre, ce quotidien restreint vu par une petite fille qui va basculer dans l'horreur. Helene Cooper ne se montre pas sous un jour favorable, elle s'assume telle qu'elle était, et telle qu'elle est devenue. Elle l'explique : à chaque fois que son passé la préoccupe trop elle se réfugie dans la superficialité.
Je me souviens du malaise immense que j'avais ressenti en interviewant Colombe Schneck, quand elle évoquait le même recours au superficiel pour lutter contre le tragique destin de sa famille ; ça sentait la justification. Ici, pas de malaise, car l'horreur de ce qu'elle, sa mère et ses sœurs ont subi nous est décrit frontalement et on comprend le besoin de rester ensuite loin du gouffre, pour ne plus jamais basculer.
Helene Cooper décrit le viol, la mort, la fuite. Elle décrit aussi ces images de guerriers toxicomanes habillés en mariées, une perruque blonde à main et une kalachnikov dans l'autre qu'elle regardait à la télévision depuis son exil américain. On y croit, on les voit presque, mais pas assez pour les ressentir. La littérature est une chose cruelle, et il manque à La Maison de Sugar Beach, d'Helene Cooper, paru au Livre de Poche, l'élan littéraire qui aurait dû hisser ce témoignage déjà bouleversant au rang de grand livre sur l'horreur génocidaire.
TL ; DR : Le récit d'une enfant gâtée libérienne dont la vie va basculer dans l'horreur, l'exil, et qui, une fois devenue journaliste internationale, va exorciser son passé.
L'audio est ici, avec en fonds sonore Warhead des Stereo Mcs.