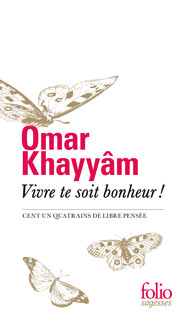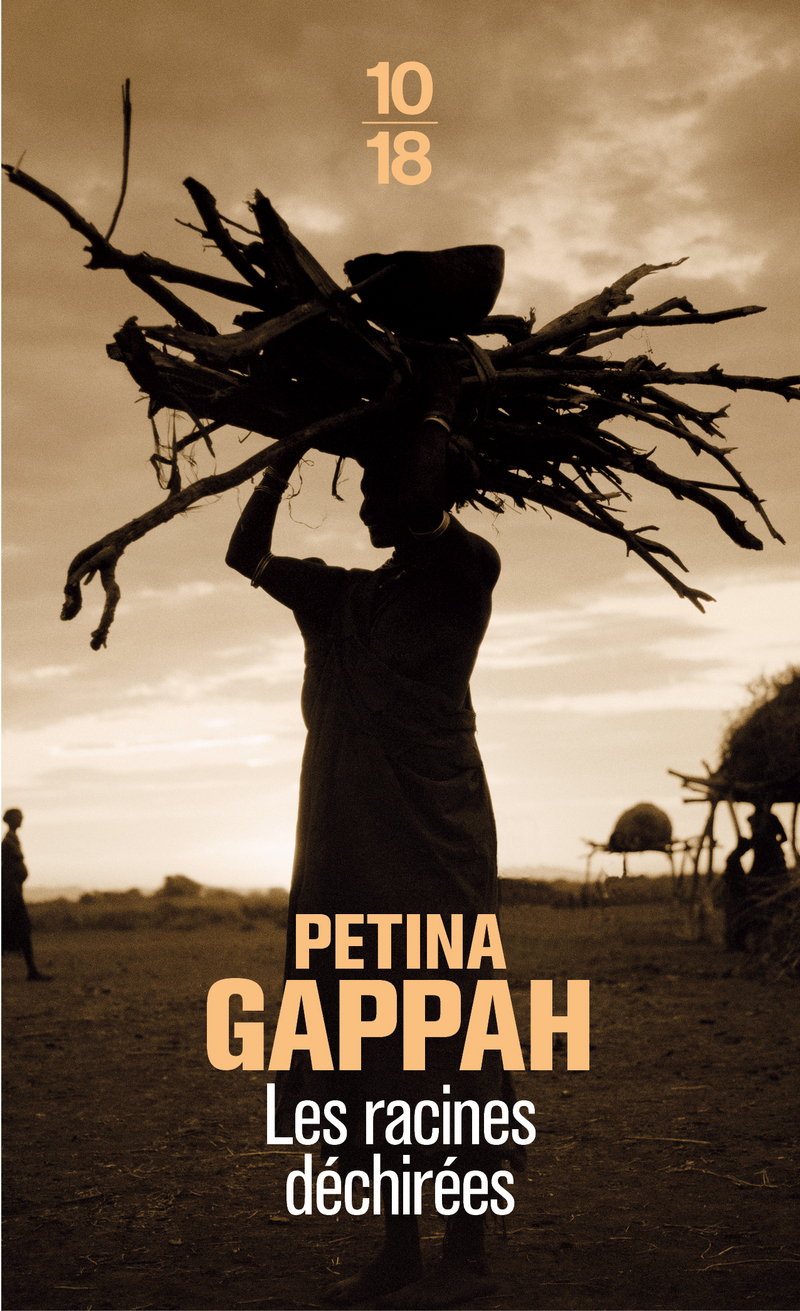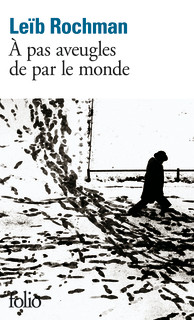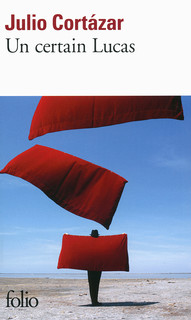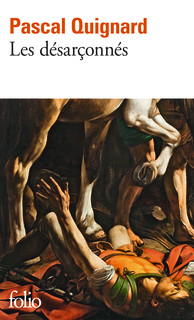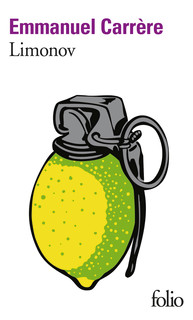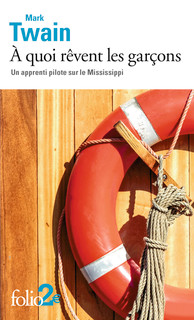 A quoi rêvent les garçons c'est Mark Twain qui raconte son expérience d'apprenti pilote sur le Mississippi. Le concept de la collection Folio 2€, c'est de découper les œuvres de grands écrivains, et de vendre des morceaux prédigérés aux lecteurs paresseux ou fauchés: on instaure en deux deux fastoche l'impôt sur l'argent de poche. Oui mais voilà, au-delà du concept, il y a des gens qui font bien leur boulot. Vraiment bien, parce que ce petit bouquin en apparence inoffensif m'a fait l'effet d'un shoot littéraire. Comme pas mal d'autres titres de la collection, d'ailleurs.
A quoi rêvent les garçons c'est Mark Twain qui raconte son expérience d'apprenti pilote sur le Mississippi. Le concept de la collection Folio 2€, c'est de découper les œuvres de grands écrivains, et de vendre des morceaux prédigérés aux lecteurs paresseux ou fauchés: on instaure en deux deux fastoche l'impôt sur l'argent de poche. Oui mais voilà, au-delà du concept, il y a des gens qui font bien leur boulot. Vraiment bien, parce que ce petit bouquin en apparence inoffensif m'a fait l'effet d'un shoot littéraire. Comme pas mal d'autres titres de la collection, d'ailleurs.
En un peu moins de 100 pages, Mark Twain fait passer nos vies pour des choses monotones, sages, et pour tout dire timorées. Enfant, Samuel Clemens veut devenir le pilote d'un des bateaux à vapeurs qui descendent et remontent inlassablement le Mississippi. Il écrit : « Nous ne pouvions pas nous engager dans la batellerie ; du moins nos parents ne nous y autorisaient-ils pas. C'est pourquoi, un peu plus tard, j'ai quitté la maison. J'ai dit que je ne reviendrai pas avant d'être devenu pilote et de pouvoir faire un retour glorieux ».
C'est ça, le style de Mark Twain. Pas seulement littéraire. Imaginez, un gamin de quinze ans que rien ne retient en arrière. Je veux être pilote. Rien de plus n'est dit sur la famille qu'il quitte. Il y a déjà une dureté invraisemblable. Et pourtant, Mark
Twain ne fanfaronne pas, il raconte avant tout les taloches qu'il reçoit quand il oublie qu'il y a ici un haut fond, là un couloir, plus loin un repère sur la berge, et cet arbre qui indique où il faut tourner. Il apprend le fleuve comme on apprend à lire, c'est lui qui fait ce parallèle, sauf que les phrases du livre changent à chaque fois qu'on les déchiffre.
Mais une fois qu'il a su lire le fleuve, qu'il a mesuré l'étendue et la puissance de ce savoir si durement acquis, il n'a qu'un seul regret : le fleuve n'a plus de poésie, pour lui. C'est peut-être pour pour la retrouver qu'il s'est mis à écrire. Une poésie brute, sans chichis, issue de la boue des rives du Mississippi, celle qui portera les immortelles aventures de Tom Sawyer et d'Huckleberry Finn.
Ce style de Mark Twain, c'est l'Amérique, c'est le style de gens qui quittent leur famille sans se retourner. Il fait entendre ces vies de travailleurs durs, farouches, roublards, et on entend la voix des sondeurs, à l'avant du vapeur. Mark Three ! Trois Brasses de fonds. Mark Twain, deux brasses. Ce n'est qu'après avoir réussi son rêve, celui d'être pilote, que Samuel Clemens choisi ce cri comme nom : Mark Twain.
On aimerait, enfin, j'aimerais, avoir cette détermination, cette persévérance, avoir une vie aussi aventureuse, on aimerait, j'aimerais tellement, avoir ce style direct et beau. Ce à quoi je rêve, c'est de savoir écrire comme Mark Twain dans À quoi rêvent les garçons, disponible dans la collection Folio 2€
L'audio est là et c'est Jimmy de Moriarty qui sert de fond sonore.