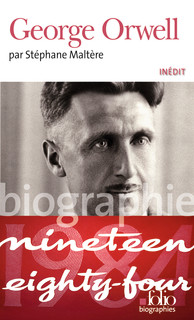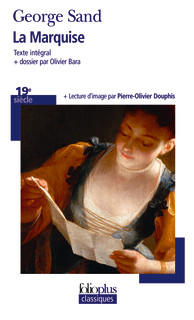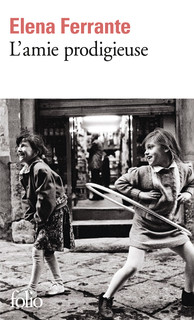 J'aimerais bien lire plus souvent des bouquins comme L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante, disponible chez Folio ou en audiobook dans la collection Écoutez lire. La narratrice s'appelle aussi Elena, et on se demande s'il s'agit d'un roman, ou d'un récit. Enfin, on se demande une page ou deux, après quoi, ça n'a plus d'importance, parce que même si tout n'est peut-être pas vrai, tout sonne juste. Elena est une bonne élève. Elle travaille, elle est gentille, studieuse, et son institutrice ne s'y trompe pas. Elle la pousse à aller au collège, ce qui, à Naples, dans les années 50, est encore un privilège de riche. Mais Elena sait que c'est son amie Lila, qui est intelligente, bien plus qu'elle. D'une intelligence prodigieuse, acérée, tranchante jusqu'à la méchanceté, parfois jusqu'à la lisière de la folie.
J'aimerais bien lire plus souvent des bouquins comme L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante, disponible chez Folio ou en audiobook dans la collection Écoutez lire. La narratrice s'appelle aussi Elena, et on se demande s'il s'agit d'un roman, ou d'un récit. Enfin, on se demande une page ou deux, après quoi, ça n'a plus d'importance, parce que même si tout n'est peut-être pas vrai, tout sonne juste. Elena est une bonne élève. Elle travaille, elle est gentille, studieuse, et son institutrice ne s'y trompe pas. Elle la pousse à aller au collège, ce qui, à Naples, dans les années 50, est encore un privilège de riche. Mais Elena sait que c'est son amie Lila, qui est intelligente, bien plus qu'elle. D'une intelligence prodigieuse, acérée, tranchante jusqu'à la méchanceté, parfois jusqu'à la lisière de la folie.
C'est tout le quartier qui est fou, avec ses mafieux, ses communistes, ses artisans, ses commerçants, ses traditions sous lesquelles on étouffe. Le prodige, c'est la façon dont Elena Ferrante parle de tout cela, sans nous perdre, sans trop en faire, sans hystérie, sans effet de manche. Le livre est impossible à résumer, parce qu'il parle autant des aspirations que des résignations, des respirations que des assignations, chacun à sa place, et chacun veut se hisser un petit peu au-dessus.
Elena et Lila grandissent, Elena apprend, Lila comprend, à l'école, dans la rue, ensemble, séparément, ensemble, le latin, l'amour, les règles et la façon de les transgresser. L'amie prodigieuse est de ces rares livres qui s'octroient une partie de votre cerveau dans laquelle les personnages vivent entre deux lectures ; ils y laissent leurs souvenirs comme si c'était les vôtres. On relit des passages sans jamais voir ce qui les rend admirables. Le style d'Elena Ferrante est sobre, calme. Implacable. Comme Lila lorsqu'elle jette la poupée de son amie dans la cave ce de Don Achille qui terrorise le quartier. Le quartier lui-même implacable, qu'une nouvelle génération veut dompter, bête ancestrale qui se nourrit des rancœurs, des règles tacites, de la reproduction du passé.
Elena et Lila sont tout le quartier, et le quartier est tout pour elle. Elles seront adolescentes quand elles en dépasseront les limites pour la première fois, et plus tard, encore, jusqu'à la mer pourtant si proche. Toute l'étroitesse des vies est racontée par ces petites choses, et l'après-guerre souffle un air de changement. La modernité qu'il nous est si facile de décrier aujourd'hui chasse un ancien temps qui n'a rien d'un bon vieux temps. La misère, voilà ce qu'elle chasse. Et l'on a presque honte du confort d'aujourd'hui, des crises qui nous laissent nos voitures, nos penderies, nos téléphones intelligents.
Au fil des heures, j'ai retrouvé cette injonction paradoxale de mon enfance : lire plus vite pour suivre Elena et Lila partout, les connaître mieux, plus, et lire plus lentement pour ne pas atteindre le dénouement et les quitter trop tôt. Et lorsqu'il arrive, c'est la colère, parce qu'on aurait aimé, oh oui, on aurait vraiment aimé, enfin, j'aurais vraiment aimé qu'il fut écrit quelque part que l'amie prodigieuse n'est que le premier volume d'une série qui en compte déjà quatre. Mais où sont les trois autres ? Ils ne sont même pas tous encore traduits en français, alors combien de temps encore avant qu'ils sortent en poche ? Pourquoi, pourquoi m'envoyer ça et me laisser pantelant, assommé par le génie d'Elena Ferrante, sans que je puisse lire la suite, tout en sachant qu'elle est écrite, là, qu'elle attend d'être lue ? Peut on savoir pourquoi Elsa Damien, qui a fait une excellente traduction de ce premier volume n'est pas en train de travailler à plein temps sur les suivants ? Que fait Gallimard, que fait la Police ? Que font les manifestants ? Il y a cinq kilomètres entre la place de la République et le siège de Gallimard, alors en passant, exigez que la suite de l'Amie prodigieuse, d'Elena Ferrante, soit publiée chez Folio au plus vite, sinon, je vais faire une bavure.
L'audio de cette chronique est ici. Avec une musique de Delphin, un zicos russe des années 2000.
Il faut noter pour la version livre audio la lecture exceptionnelle de Marina Moncade.